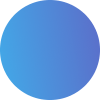Mathieu Dumas : Au moment où tu as intégré le Centre National d’Entraînement, tu continuais toujours tes études. Qu’est-ce qui t’a poussé à te consacrer au tennis à temps plein ?
Florent Serra : C’était le deal avec mes parents. Je voulais rester, au moins jusqu’au bac, dans mon cocon familial et j’ai donc refusé d’aller à Poitiers où je serai rentré seulement les week-ends. À 13 ans, ça ne me convenait pas. Sans être le meilleur, j’ai toujours été parmi les 10 meilleurs joueurs français, même si on ne m’a jamais proposé d’intégrer l’INSEP. J’étais bien dans ma Ligue, j’avais de bons entraîneurs et surtout j’étais chez moi. L’année où j’ai passé mon bac ES, j’ai pris mes premiers points ATP et j’ai ensuite intégré le CNE avec un bon groupe d’espoirs. Mais malgré ça, je voulais avoir une bon de sortie au cas où je ne faisais pas carrière dans le tennis donc je suis parti sur un DEUG en LEA. Je dois dire que ça ne m’a pas beaucoup plus donc en fin de première année, j’ai décidé de me recentrer sur le tennis.
MD : À un certain moment, le jeune joueur de tennis est amené à faire un choix. On pèse le pour et le contre ou on fonce, car l’opportunité est trop belle ?
FS : Quand le rythme des entraînements a augmenté, je me suis blessé à la hanche pendant 4 mois. On m’a même dit que je devais arrêter le tennis. Mais j’ai de nouveau bien joué et j’ai repris des points ATP, puis les tournois s’enchaînent, on voyage tout le temps. Je crois que la décision s’est faite naturellement.
MD : Longtemps sur le circuit challenger, tu as attendu plusieurs années avant de disputer ton premier match ATP. Il y a des moments où on a peur de ne pas passer le cap ?
FS : Bien sûr. Quand tu galères pendant trois ans sur des tournois Challenger et que tu n’arrives pas à franchir la 150e place mondiale, tu te poses des questions. Tu ne gagnes pas ta vie, tu voyages beaucoup, il y a des frais donc au bout d’un moment, il y a un certain ras-le-bol. Je me souviens d’un tournoi, perdu au fin fond du Mexique et je me souviens avoir appelé mes parents après avoir perdu en qualification d’un tournoi challenger. J’étais avec Jo-Wilfried Tsonga et il m’avait dit : « De toute façon, je vais gagner le tournoi » et il l’avait remporté. Ça m’a fait un déclic et m’a poussé pour la suite. À mon tour j’ai dit à Jo : « la semaine prochaine, c’est moi qui gagne. » Je me suis préparé comme un fou et j’ai décroché le titre à Mexico. Je suis grimpé à la 150e place et j’ai surtout pris un gros boost de confiance.
MD : Quelques mois après, tu remportais ton premier titre ATP à Bucarest en 2005. Tu as eu le sentiment de passer un cap ?
FS : Dans la tête oui. Tu t’approches du Top 50 donc ça change évidemment beaucoup de choses, que ce soit financièrement, au niveau de la confiance et du niveau de jeu. J’ai de nouveau gagné un tournoi en janvier de l’année suivante en battant de bons mecs. Quand tu as ce classement-là, tu joues les qualifs de Masters, parfois même tu rentres directement dans le tableau, j’avais eu une wild-card à Bercy. Pour rentrer dans les ATP 250, ce n’est plus un problème non plus. Et puis surtout, avec la confiance, tu gagnes des matchs donc tu arrives à te maintenir.
MD : Pour rebondir sur l’aspect financier, c’est John Isner qui expliquait qu’il ne restait pas grand-chose aux joueurs sur leur prize money une fois que tout avait été payé. C’est quelque chose que tu as vécu ?
FS : Il a tout à fait raison ! Tu payes tous tes voyages, parfois en business quand tu vas en Australie, tes raquettes, tes cordages, tes restos, ton staff. Moi qui ai toujours eu des problèmes de hanche, je voyais très souvent le kiné et ça me coûtait environ 25 000 euros l’année. Puisque je m’entraînais à la Fédé, je leur versais également 8% du total de mon prize money donc sur une grosse année ce sont des sommes qui peuvent monter jusqu’à 40 000-50 000 euros. Après, c’est toujours moins que ceux qui ont des structures privées avec un entraîneur attitré. Là, ça peut vite monter à 100 000 euros l’année. Ajouté à ça, tu as 50% qui part en impôts. Les dotations ont bien changé, à mon époque, c’était 15 000 euros pour un premier tour de Roland Garros, maintenant, c’est 60 000. Les joueurs de tennis ne sont pas à plaindre, mais comme le disait Isner, beaucoup ne gagnent pas énormément d’argent.
MD : Même si l’exposition était moindre à l’époque, est-ce qu’on est préparé à cette médiatisation ?
FS : Pas assez dans la mesure où c’est quelque chose qui arrive très vite. L’année qui a suivi mon entrée dans le Top 100 est très importante puisque c’est là où je rentrais dans tous les Masters 1000. Je ne m’en suis pas trop mal sorti, mais ça aurait pu être dix fois mieux et là, ta carrière peut basculer dans une autre dimension. Personnellement, j’étais quelqu’un d’assez discret, je n’avais pas la grosse tête et je pense avoir été parfois trop gentil. Jouer un Nadal sur un central, il faut y être préparé. Je ne l’ai pas trop mal géré, mais selon moi, pour arriver encore plus haut, il faut être un peu imbu de sa personne et avoir une haute estime de soi.
MD : Ces grands matchs justement. Quand on est joueur professionnel, est-ce qu’on reste impressionné par des joueurs comme Federer, Nadal ou Djokovic ?
FS : Moi, trop malheureusement ! J’avais dû mal à affronter les très grands joueurs. Le premier que je gère très mal, c’est un match face à Andy Roddick au premier tour de l’US Open 2006, puis ça a été le cas contre Rafa sur le central de l’Open d’Australie deux ans plus tard. Le problème, c’est que je regardais ces joueurs-là avec les yeux d’un enfant. On aurait dit que c’était eux qui avaient 5 ou 6 ans de plus que moi. Il m’a vraiment fallu du temps pour me dire « Attends, toi aussi tu y es, tu es légitime ! » Djokovic, je le bats à Cincinnati pour aller en 8e de finale et lorsque je l’ai joué de nouveau après qu’il ait gagné des Grands Chelems, je ne le vois plus de la même manière et je me crispe. Parfois, j’ai eu des blocages en fonction de l’aura du joueur. Tout réside dans l’approche de ces matchs. Au fil des années, j’ai mieux géré ça. Celui contre Federer était plutôt pas mal (défaite 7/6 7/6 au 3e tour de Miami en 2010 ndlr) et j’ai aussi battu plusieurs joueurs du Top 10 que ce soit Davydenko, Robredo ou Blake.
MD : Quel est le plus beau match de ta carrière selon toi ?
FS : Avoir battu James Blake, 8ème mondial, chez lui à Miami, c’était un gros match pour moi et bien sûr ce duel face à Federer qu’on mentionnait plus tôt, où j’ai réussi à produire un très bon tennis. Lorsque je suis titré à Bucarest, je joue vraiment l’acier toute la semaine, mais je vais citer un autre match qui peut paraître assez banal, au second tour de l’Open d’Australie en 2010 contre Jarko Nieminen. J’avais joué cinq sets la veille et je suis mené 2 sets à 1 avec balle de match au quatrième. Je commençais à avoir des crampes dans le quatrième, mais j’arrive à tenir. À 5-5 dans le cinquième, je sauve une balle de break sur un plongeon à la volée et derrière je gagne 7-5. C’était un grand souvenir. Malheureusement, je joue Murray derrière et je ne pouvais plus bouger.
MD : 36e mondial, 2 titres ATP, 5 victoires sur le Top 10, quel bilan tires-tu de ta carrière ?
FS : Je n’ai pas joué beaucoup de juniors donc on va dire que je n’étais pas, à un jeune âge, forcément destiné à cette carrière. À 18-19 ans, je savais que j’allais tenter le coup, mais je ne savais pas que je deviendrais professionnel. Je n’étais pas dans le processus d’un Carlos Alcaraz qui est programmé depuis 10 ans pour ça. Évidemment, j’ai des regrets sur plusieurs matchs. J’ai le sentiment d’être passé tout proche d’un dernier carré de Masters 1000, d’une deuxième semaine de Grand Chelem. Je ne te cache pas que je suis quand même super content, parce que j’aurais signé largement pour la carrière que j’ai eue, mais il y a des choses que j’aurais pu mieux gérer. Il y avait plus de fierté et d’estime de soi à avoir pour pouvoir aller battre et défier les meilleurs, même si parfois je l’ai fait.
MD : La retraite est-elle vraiment vécue comme une « petite mort » pour le sportif ?
FS : Bien sûr, beaucoup de choses changent. Et puis je n’ai pas eu d’hommages à Roland Garros ou je ne sais quoi, même si j’étais en Coupe Davis. On ne m’avait même pas accordé une wild-card pour les qualifications ! C’est assez brutal, mais la transition immédiate vers un rôle de consultant m’a vraiment aidé. Cela me permettait de rester dans le monde du tennis, tout en étant proche de ma famille, pour moi, c’était parfait.
MD : En 2018, tu avais été candidat au capitanat de l’Équipe de France de Coupe Davis, c’est un challenge qui t’aurait plu ?
FS : Oui avant l’arrivée de Sébastien Grosjean, quand Amélie Mauresmo arrête. Je l’avais proposé aux gars parce que je pense qu’il y avait un truc à faire. On était de la même génération, je les connaissais, mais c’est quelque chose de trop politique pour moi. Et puis il y a cette tradition qui veut qu’il faille avoir été Top 10 ou avoir remporté la Coupe Davis pour devenir capitaine. Ce n’est pas le cas dans les autres sélections. En tout cas, j’estime que quelqu’un qui connait le haut niveau, qui connaît bien les gars et qui sait se faire respecter peut très bien faire du bon boulot.
MD : Le coaching est-il quand même dans un coin de ta tête à l’heure actuelle ?
FS : Non, je n’ai pas envie de voyager. Je devais être capitaine de l’équipe de France 15-16 ans, mais cela ne s’est pas fait avec le Covid. Actuellement, je suis très heureux comme consultant, même si tout peut aller également très vite avec les droits télés. Mais si un ancien Top 10 arrive sur la chaîne, tu peux vite être prié d’aller voir ailleurs. C’est une question d’image.